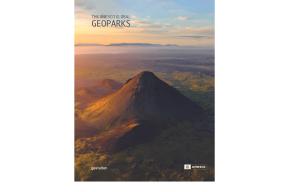Article
Faut-il se ressembler pour traduire?
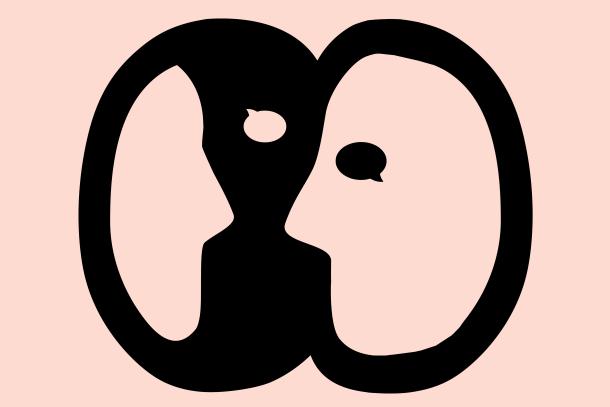
Lori Saint-Martin
Professeure en études littéraires à l’Université du Québec à Montréal, Lori Saint-Martin est essayiste, romancière, interprète de conférence et traductrice littéraire (de l’anglais et de l’espagnol au français). Elle a récemment publié Un bien nécessaire, éloge de la traduction littéraire (2022).
Rencontre d’au moins deux langues et deux cultures, la traduction est inséparable de la diversité. Elle demeure une expérience profonde de l’altérité, même dans les cas où la personne traduite nous ressemble sur le plan culturel. Et beaucoup de traducteurs, tombés amoureux d’un livre écrit par une personne « racialement » et culturellement très différente d’eux, ont cherché un éditeur prêt à accueillir les mots de cet auteur dans la nouvelle langue. C’est notamment pour cette raison que la controverse survenue en 2021 autour de la traduction d’un poème d’Amanda Gorman a blessé nombre d’entre eux.
Rappelons brièvement les faits : dès l’annonce, par la maison d’édition néerlandaise Meulenhoff, du choix de Marieke Lucas Rijneveld, jeune personne non binaire qui venait de remporter avec un premier roman l’International Booker Prize, pour traduire « The Hill We Climb », le poème lu par Amanda Gorman à la cérémonie d’investiture du président américain Joe Biden, une journaliste, Janice Deul, a demandé pourquoi l’éditeur n’avait pas plutôt choisi une jeune femme noire. Très vite, Rijneveld a annoncé son retrait du projet, et de nombreuses personnalités du monde littéraire, scandalisées, ont réclamé le droit de traduire, sans restriction, des personnes très différentes d’elles.
Prévisibles et, dans un sens, compréhensibles, mais peu nuancées, ces protestations ont vite fait de tuer le débat dans l’œuf. Pour ma part, je crois que la question est très complexe : ni la rhétorique des droits (« j’ai le droit de traduire qui je veux »), ni le langage des diktats identitaires (« seule une jeune poétesse noire devrait pouvoir en traduire une autre ») ne permettent d’y apporter une réponse définitive.
Poser la question « Qui peut traduire qui ? », c’est faire de la politique aux dépens de la littérature, affirment certains. À les entendre, le monde de la traduction est – ou plutôt était – parfaitement juste et harmonieux jusqu’à l’irruption dans la bergerie de la louve de la diversité. Mais c’est faux : le milieu de l’édition, dont celui de la traduction fait partie, est traversé par des rapports de force que l’affaire Amanda Gorman aura au moins eu le mérite de mettre en lumière : rapports de genre, de « race » et de classe, rapports géopolitiques.
Une diversité en trompe-l’œil
L’abondance de titres traduits sur les tables de nouveautés des librairies nous donne la fausse impression d’avoir accès à des œuvres du monde entier, alors qu’en réalité, quand on y regarde de près, la « diversité » mondiale est plutôt uniforme : quelques langues, quelques pays, une élite internationale, des personnes dominantes, en somme. L’histoire de la traduction, jusqu’à tout récemment, est celle d’hommes blancs bien nantis se traduisant entre eux ou traduits par des femmes.
L’histoire de la traduction, jusqu’à tout récemment, est celle d’hommes blancs bien nantis se traduisant entre eux
Aujourd’hui comme hier, la traduction se trouve prise dans les filets des rapports de domination entre Nord et Sud, entre « races », langues et cultures hégémoniques ou non. Les autrices racisées d’outre-frontière qui nous parviennent en traduction font en général partie d’une élite mondialisée qui écrit dans la langue de l’ancien colonisateur (anglais, français, espagnol, portugais, néerlandais, italien…) et publie à New York, à Londres, à Paris. Pour une autrice indienne traduite de l’hindi, du marathi ou du malayalam, par exemple, on en compte des dizaines, voire des centaines, traduites de l’anglais. Même au sein d’un groupe minoritaire, opprimé ou marginalisé, des hiérarchies complexes émergent. Tout en subissant du racisme chez elle, une écrivaine noire états-unienne bénéficie, à l’extérieur, de l’hégémonie mondiale de son pays ; elle a beaucoup plus de chances d’être traduite et diffusée à l’international qu’une femme noire qui habite le continent africain et écrit, disons, en wolof. Pour qu’on vous prête du capital culturel, vous devez en posséder déjà.
Même s’il est difficile d’obtenir des statistiques d’ensemble, il apparaît que les hommes sont davantage traduits que les femmes. Au plus fort du boom latino-américain, on ne traduisait presque aucune écrivaine, et une génération d’autrices importantes (Cristina Peri Rossi, Luisa Valenzuela, Elena Garro, Silvina Ocampo) est restée dans l’ombre. Entre 2011 et 2019, environ 26 % des œuvres de fiction ou de poésie traduites aux États-Unis étaient signées par une femme.
J’entends d’ici les apôtres de la « grande littérature universelle » (notion fabriquée et entretenue par les dominants) déclarer que ce sont les meilleurs textes qui devraient être diffusés dans le monde. Mais qui fait les choix éditoriaux, sinon les gens qui dominent déjà ? Ce que les apôtres de la liberté absolue des traducteurs négligent souvent de mentionner, c’est précisément à quel point le milieu de la traduction est blanc. Aux États-Unis, une étude menée par l’Authors Guild en 2018 2017 a révélé que 83 % des traducteurs actifs étaient blancs et que seulement 1,5 % d’entre eux étaient noirs ou africains-américains.
Sortir de l’entre-soi
La profession doit donc s’ouvrir à des traducteurs nouveaux et divers au lieu de demeurer la chasse gardée des personnes blanches. On a beaucoup parlé de l’importance, pour les groupes discriminés, de disposer de modèles : si les gens « comme vous » n’ont jamais écrit, vous aurez du mal à vous imaginer écrivain. De la même façon, si la très grande majorité des traducteurs sont blancs et de classe moyenne, comment une personne de la diversité peut-elle s’imaginer percer dans le domaine ?
Cela dit, les affinités ne sont pas toujours identitaires : elles peuvent avoir trait au style, à la voix, au sujet. D’autres points de rencontre profonds peuvent créer l’énergie nécessaire à la traduction. Un de mes livres de fiction a été traduit vers l’anglais par un Québécois beaucoup plus jeune que moi et vers l’espagnol par un Argentin un peu plus âgé. Jamais je n’ai pensé qu’ils étaient disqualifiés par le fait d’être des hommes ou de différer de moi d’autres façons.
Le romancier franco-congolais Alain Mabanckou a une formule amusante à propos du choix d’un traducteur : « Pour moi, peu importe la couleur du chat, pourvu qu’il attrape la souris. » D’autres trouveront fondamentales les origines du chat. Certaines personnes issues de groupes dominés ou marginalisés préfèrent être traduites par quelqu’un qui leur ressemble ; d’autres accueilleront avec bonheur la demande d’une personne « non diverse ».
On assistera dans les prochaines années – c’est commencé depuis peu – à l’émergence de traducteurs appartenant à des groupes ou à des milieux minoritaires ou minorisés. Mais comme la compétence ne découle pas seulement des variables identitaires, il faudra éviter de cantonner ces personnes à « leur » groupe, à moins qu’elles ne préfèrent s’y consacrer exclusivement.
Revenons enfin au « cas » d’Amanda Gorman. Sans affirmer qu’aucune personne blanche n’aurait été à même de bien la traduire, je crois que, dans ce cas emblématique et hautement médiatisé, le choix d’une jeune traductrice noire aurait été non seulement un magnifique geste symbolique et politique mais aussi un geste d’appui pour la diversité.
Plus généralement, c’est en partie par souci d’équité sociale qu’il importe de traduire des personnes moins privilégiées et plus diversifiées. Pour faire entendre d’autres voix, étouffées par une fausse mondialisation qui est le visage à peine actualisé du colonialisme d’autrefois.
La traduction nous secoue, elle décentre le centre et trouble la pensée unique
On traduit (et on lit des traductions) pour ne pas se trouver dans un « entre nous » factice, violent, créé par l’effacement et l’exclusion. La traduction nous secoue, nous montre que nous ne sommes pas le nombril du monde ; elle décentre le centre et trouble la pensée unique. À son meilleur, elle est la diversité même, le monde, des mondes, à portée de main.